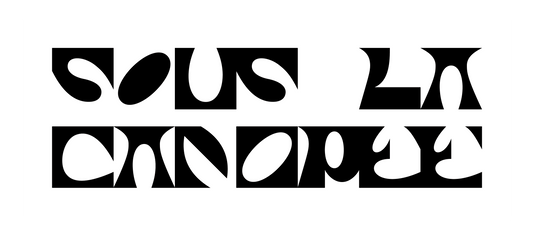L'oïdium
Share
L’oïdium est le nom générique d’une maladie causée par un champignon. Il s’applique à plusieurs taxons distincts, c’est la raison pour laquelle son nom vernaculaire est ambigu. On l’identifie par un feutrage blanchâtre à grisâtre d’aspect duveteux sur les feuilles, bourgeons, fleurs et jeunes tiges. Les feuilles boursouflent, se déforment et se replient sur elles-mêmes. Les organes se dessèchent et les bougeons avortent.

PÉRIODE À RISQUE
L’oïdium préfère l’été et l’automne lorsque la végétation est bien développée ou en fin de végétation. La période de développement du champignon peut varier en fonction des conditions climatiques locales et annuelles.
FACTEUR À RISQUE
L’arrosage sur le feuillage des plantes associé à un sol sec, ainsi que les gelées tardives sont des facteurs favorisant le développement des spores et par conséquent de la maladie. L’oïdium se développe rapidement dès que les températures deviennent supérieures à 12°C (optimum vers 25°C) et quand l’humidité relative est comprise entre 40 et 100 %. Le contraste des températures, nuit fraiche et humide suivie par une journée chaude favorise le développement du champignon. En revanche, l’eau libre et la lumière intense gênent la germination des spores et le développement du mycélium. Une fumure azotée excessive favorise également son développement.
FORME HIVERNALE
En automne et en hiver, le champignon se conserve sur les feuilles mortes ou entre les écailles des bourgeons. Il peut hiverner sous deux formes : soit sous une forme mycélienne entre les écailles des bourgeons de la pousse d’août, soit sous forme de fructifications noires (petites ponctuations) sur des feuilles tombées à terre. Néanmoins, cette deuxième forme se rencontre rarement.
ORGANE SENSIBLE
Les parties aériennes. Par exemple : les faces inférieure ou supérieure des feuilles, les inflorescences, les bourgeons, les fruits, les tiges, les épines, les vrilles, etc. STADE SENSIBLE Tous les stades sont sensibles mais plus particulièrement les jeunes sujets.
IMPORTANCE DES DÉGÂTS
L’oïdium est une maladie rarement mortelle. Cependant, en l’absence de traitement, les boutons floraux avortent pour les plantes ligneuses et, à terme, la croissance de la plante ralentit. Il se peut que la plante meure.
Cycle de vie et biologie
L’oïdium possède deux cycles de reproduction :
- La reproduction asexuée est assurée par le mycélium qui envahit les bourgeons dans lequel il hiverne. Dès le début du printemps, les filaments mycéliens se développent et contaminent des jeunes pousses en croissance. Les conidies se déciment et contaminent les organes végétatifs.
- La reproduction sexuée génère la formation de cléistothèces à la fin de l’été, ce sont les organes reproducteurs de l’oïdium. En hiver, ils se conservent dans les feuilles mortes et les écorces. Au printemps, ils libèrent des ascospores qui contaminent les organes végétatifs. Dans les deux cas, lorsque les conditions sont favorables, différents facteurs comme le vent, la pluie, les traitements, etc. assurent la propagation du champignon. Il y a germination et formation d’un nouveau mycélium, donc production de conidies et ainsi de suite.

PRATIQUE CULTURALE
- L’humidité favorise le risque de contamination par des maladies cryptogamiques comme l’oïdium.
- Désinfecter les outils de coupe entre chaque plante pour éviter la transmission de la maladie avec du vinaigre.
- Mesurer correctement le besoin en eau, un manque ou un excès affaiblit la plante et la rend plus sensible aux attaques du champignon.
- Dans le cas de plantes sensibles, arroser le matin et de façon modérée au pied des plantes en évitant de mouiller le feuillage.
Lutte curative à faible risque : préparation à partir de substance végétale
URTICA DIOICA – ORTIE : L’ortie stimule la croissance végétale, il est utilisé comme fongicide et acaricide. Laisser macérer 75 gr de plante fraîche ou 15 gr de feuilles séchées dans 1 L d’eau. Choisir de jeunes pousses non montées en graines, propres et nettoyées. La fermentation peut être facilitée si l’ortie est préalablement hachée. Mélanger la préparation quotidiennement. Laissez macérer 3-4 jours à 20°C. Filtrer la macération et diluer le filtrat 5 fois dans de l’eau potable. Placer la préparation dans un récipient fermé et identifié. Pour garantir une bonne préparation, assurez-vous que le pH soit entre 6 et 6,5. Pulvériser directement sur le feuillage dès les premiers symptômes Appliquer au printemps, toutes les 2 semaines, particulièrement si le temps oscille. Par temps sec et chaud, espacer. Faire attention à l’excès d’azote que peut apporter cette préparation. Application d’un paillis/mulch : Mélanger 83 g d’ortie sèche (partie aérienne) par kg de paillis/mulch.
EQUISETUM ARVENSE – PRÊLE : La prêle renforce les défenses naturelles des plantes. Elle permet aux végétaux d’enrober de silice leurs jeunes cellules. 200 g de parties aériennes d’Equisetum arvense séchées sont mises à macérer dans 10 L d’eau durant 30 minutes (trempage) et ensuite bouillies durant 45 minutes. Après refroidissement, la décoction est filtrée avec un tamis fin et ensuite diluée 10 fois dans de l’eau. Par conséquent, la concentration théorique en partie aérienne de plante séchée présente dans la décoction est de 20 g / L, qui est ensuite diluée par 10, d'où 2 g / L dans la préparation finale appliquée sur les plantes. La préparation ainsi réalisée doit être appliquée dans un délai maximum de 24 heures, pour éviter l'oxygénation et la potentielle contamination microbiologique qui peut se produire durant le stockage. Le solvant pour l’extraction et la préparation est l’eau (eau de source ou eau de pluie) et présentant un pH de 6.5. Pulvériser directement sur le feuillage dès les premiers symptômes. Appliquer au printemps, toutes les 2 semaines, particulièrement si le temps oscille. Par temps sec et chaud, espacer. Ne pas traiter en plein soleil, risque de brûlures.
LÉCITHINE : La lécithine est un lipide, notamment présent dans certains végétaux, qui dispose de propriétés antifongiques. Elle doit être utilisée dans une solution d’eau froide pour être appliquée dans les différentes cultures. La lécithine doit être diluée conformément au taux d’application renseigné ici. En diluant 5 gr dans 1 L d’eau, on peut pulvériser le mélange directement sur le feuillage d’avril à septembre. A utiliser maximum 12 fois par an avec un intervalle de 5 jours entre chaque pulvérisation. Utiliser avec précaution et ne pas appliquer au soleil.
ALLIUM SATIVUM & THYMUS SERPYLLUM – AIL ET SERPOLET : L’ail et le serpolet ralentissent le développement des champignons. D’un côté, préparer un mélange de 20 gouttes d’huiles essentielles dans une noisette de savoir noir et dans la même quantité d’eau. De l’autre, réaliser du lait d’argile à l’aide d’1 L d’eau et d’une cuillère à café d’argile. Mélanger le tout. Pulvériser directement sur le feuillage au besoin. Utiliser avec précaution car les principes actifs sont concentrés et la toxicité est élevée.
Lutte curative à faible risque : préparation à partir de substance de base
NaHCO₃ - BICARBONATE DE SOUDE : Le bicarbonate de soude empêche la formation des spores des champignons grâce à son ph basique. L’hydrogénocarbonate de sodium doit être dilué conformément au taux d’application renseigné ici. Pulvériser directement sur le feuillage de mai-juin à août. Renouveler au besoin (1 à 8 applications par an avec au minimum un intervalle de 10 jours entre chaque) et après un épisode pluvieux. Attention au risque de brûlure des feuilles si le dosage n’est pas correctement respecté.
Lutte curative chimique : produits phytopharmaceutiques
Il est important de rappeler que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans les espaces publics et que les biocides sont soumis à cette législation. En dernier recours, l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques reste possible dans des cas particuliers et dans le respect des législations régionales et nationales. Procéder à une analyse de risque et sélectionner le produit le moins préoccupant pour la santé et l’environnement. En boutique nous vendons des insecticides BIO.
Source: Bruxelles Environnement INFO-FICHES SUR LES ESPACES VERTS ET LA BIODIVERSITÉ EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE